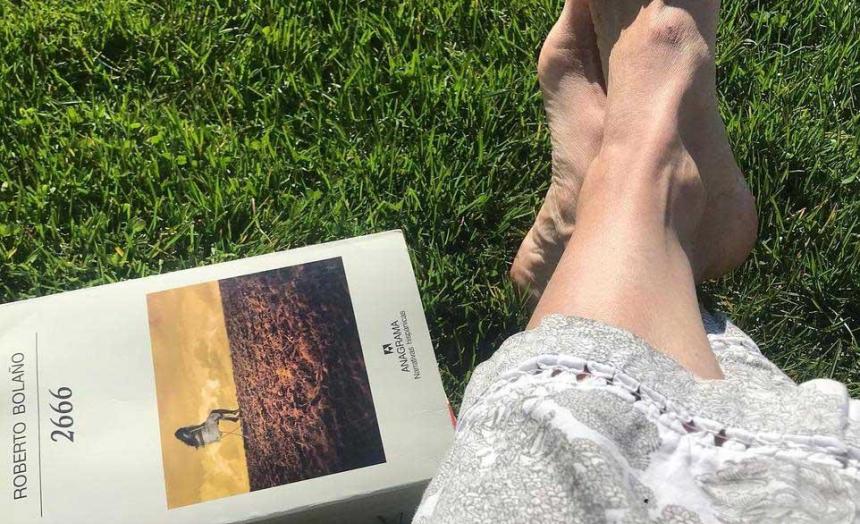— La cuillère ne serve plus maman a été lâchée” dit Rapha.
— « Lécher ou licher ? Comment dit-on ? » s’interroge le présentateur d’une radio à Mexico.
Je commence à douter de la façon de dire les choses en espagnol et j’en tremble. Ici la radio me rappelle ce que je suis en train d'oublier.
— « J’adore que nous soyons ici maman, de ce côté de la côte », dit Emma.
— « Oui, je lui réponds, nous regardons la vie de ce côté, j’ai ressenti la même chose que toi. »
J’ai commencé à lire, au début du confinement de la Covid-19, 2666, le roman posthume de l’écrivain chilien Roberto Bolaño (1953-2003) publié en 2004. J’allais chercher la face cachée d’un Mexique qui m’avait envoûtée. Je suivais également les traces de ce premier voyage où j’avais choisi d’aller, non pas pour m'évader mais pour me créer un monde nouveau, une autre forme de féminité.
Lors de mon premier voyage au Mexique, je suis arrivée à Oaxaca. J’ai parcouru la ville, en inventant son histoire aux coins des rues, de ses places, de ses églises, dans une librairie et dans ses étals de nourriture, dans ses habitants et dans ses bars. Sa culture au sein de ses musées, du textile ou de l’art contemporain, m’a tout autant émue que ses marchés ou les branches de bougainvilliers qui tapissaient les murs. C’était pour moi une ville habitée par des « cronopes » (personnages fictifs inventés par l’auteur argentin Julio Cortazar). Et pourtant, je ne pouvais voir où se cachaient les « fameux » (autres personnages fictifs créés par le même auteur, dans son livre « Cronopes et fameux »).
Lors de mon deuxième voyage à Mexico, mon enchantement était intact, mais c’était cette fois plus urbain. L’immensité des monuments historiques de la ville (signes de quelle immensité?) vous obligent à lever les yeux toujours plus haut, presque jusqu’à chavirer pour pouvoir les voir dans leur ensemble. Le rideau de verre du Palacio de Bellas Artes, les librairies comme les bibliothèques et les temples, la tour de La Reforma et moi, figée sur le Paseo de la Reforma, ne sachant pas si je dois traverser ou continuer, écoutant les murmures d’une ville qui vous parle tout le temps. Moi, clouée entre les rafales « parce qu’à cette heure-là, le vent nocturne qui est trop fort pour la nuit courre sur Reforma » (Amulet de Bolaño, 1999). Pour mon bonheur, nous sommes unis par la même langue, et c’est cette arme puissante qui me permet de pénétrer dans les interstices de la ville et de ses habitants.
Le Mexique a une force qui vous attire et même les chinois, avec leur culture millénaire, finissent par cuisiner du maïs et de l’avocat; je présume qu’à Buenos Aires ce ne serait pas le cas.
2666 est un roman sur le Mexique, vaste, ambitieux et oú l’on sent la mort qui nous guette. Il est composé en cinq parties qui peuvent être lues séparément par le lecteur. L’auteur a consacré les dernières années de sa vie à ce travail mais les idées existaient bien avant. Je me suis demandée s’il avait essayé de se trouver, et aussi de dire au revoir à l’immensité de ce pays, avec cette oeuvre colossale qui ouvre sans cesse la voie de l'inconnu.
L’écriture de 2666 a occupé Bolaño les dernières années de sa vie. Mais la conception et l’organisation du roman sont beaucoup plus anciennes. Avec le recul on peut reconnaître son battement dans tel ou tel livre, et plus particulièrement dans ceux publiés après la conclusion de Les détectives sauvages (1998), qui ne se termine pas par hasard dans le désert du Sonora, comme le précise Ignacio Echevarría dans les Notes de la première édition (2004).
Bolaño, comme les personnages du roman, construit durant des années une ligne de sens, d’évasion, qui converge vers Santa Teresa. Selon Echevarría, dans une de ces nombreuses notes relatives à 2666, Bolaño signale l’existence dans l’oeuvre d’un « centre caché », qui serait derrière ce qu’on voit habituellement, un « centre physique » pour ainsi dire. Il y a des raisons de penser que ce centre physique serait la ville de Santa Teresa, une transcription fidèle de Ciudad Juaréz, à la frontière du Mexique et des Etats-Unis.
Les cinq parties du roman convergent à Santa Teresa. Quelle est cette ligne de fuite vers laquelle s’oriente le sens du livre ? Un sens élevé du risque, un désir insensé de tout couvrir, et qui vous amène au bout de ses pages, en suivant les traces d’Archimboldi, l’un des protagonistes. On a le sentiment que bien que le roman ne puisse pas tout couvrir, l’oeil du narrateur, lui, a bien tout vu.
En tant que lectrice, dans le chapitre sur les crimes avec les innombrables victimes, j’ai trouvé les innombrables formes de ma féminité que j’avais commencé à explorer lors de mon premier voyage au Mexique. J’ai ressenti un frisson de peur et je me suis retournée vers la sécurité de ma maison, de mon quartier et de ma ville pour finir par penser que ce chapitre devrait être lu dès le plus jeune âge dans toutes les écoles de mon Amérique latine.
J’ai terminé de lire 2666 sur une île de la Baie georgienne en Ontario, à l’heure où devait commencer mon émission de radio préférée à Mexico. Ça n’a rien à voir, et pourtant ça a tout à voir… On arrive quelque part comme on arrive à certains livres, en cherchant à comprendre, à travers un certain centre physique qui nous attire à la terre, le centre de soi-même à l'intérieur de sa coquille. Ce sud que nous portons à l'intérieur de nous, qui n’est rien d’autre que l’espace indomptable de chacun, un pont imaginaire qui s'étend entre le monde réel et la fiction, un pont qui fait appel à l’imagination pour créer et se libérer, dans le simple but d’exister.
Et c’est ainsi qu’à travers la lecture d’un livre, notre monde finit par en trouver un autre. Je bois un maté, et si j’en avais, je me boirais un mezcal.